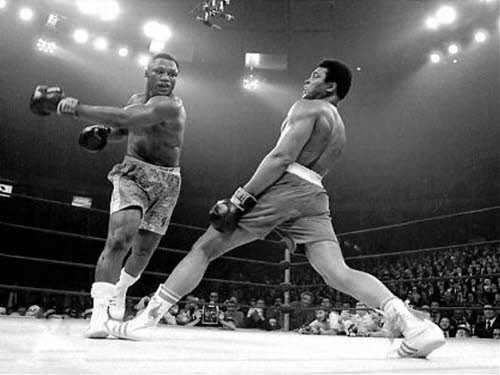Un chiffre en dit plus que mille slogans. En 2024, la France a battu un record avec 1 111 200 créations d’entreprises, soit un rebond de 6% après 2023 (INSEE – Créations d’entreprises en 2024). Derrière ces numéros se joue une réalité simple. Lorsque le capital trouve ceux qui prennent des risques et innovent, le niveau de vie progresse. Cette évidence est au cœur d’une réflexion impulsée par un post de Charles Gave. L’assertion « je déteste le capitalisme » revient souvent dans le débat public. Elle repose le plus souvent sur une méprise. Le capitalisme n’est ni un culte du profit, ni une idéologie morale. C’est un système d’allocation du capital et un apprentissage collectif pour décider qui l’utilise, à quelles conditions, selon quelles règles.
Ce que ce mot signifie vraiment
Le capitalisme renvoie d’abord au capital, mot hérité du latin « capitale », lié au bétail et à la notion de propriété. La richesse n’était pas une abstraction mais des biens qui produisent un revenu régulier et durable. L’intuition de base reste valable. Préserver et faire croître un stock d’actifs améliore le sort des générations suivantes. Anéantir son capital appauvrit la famille puis la société. L’économie moderne traduit ce mécanisme avec des machines, des brevets, des compétences, des logiciels, des fonds propres et de l’épargne longue. Le capitalisme se résume à une question d’organisation. Qui obtient le droit d’utiliser les ressources rares pour créer demain davantage de richesses qu’aujourd’hui.
Le code de la route de l’économie
La métaphore proposée par Charles Gave permet de clarifier. Un réseau routier efficace n’existe pas sans règles, responsabilité, permis, sanctions. Le capitalisme fonctionne de la même manière. Droits de propriété clairs, contrats exécutoires, faillite pour ceux qui échouent, rémunération pour ceux qui réussissent. Détester ces règles revient à refuser le pilotage par des professionnels des avions de ligne. Le résultat est prévisible. Moins d’investissements, plus de gaspillages, une économie figée.
Pourquoi ce système élève le niveau de vie
L’histoire économique répond de manière empirique. Lorsque les droits de propriété sont mieux définis et que les marchés du capital fonctionnent, l’investissement et la productivité progressent. Le long terme confirme cette mécanique. La durée de vie moyenne s’est envolée à l’échelle mondiale et la pauvreté extrême a reculé sur plusieurs décennies. Les sociétés qui ont sécurisé l’épargne et l’entrepreneuriat ont capté ce dividende de croissance. En France, malgré des cycles difficiles, le pouvoir d’achat par unité de consommation a augmenté sur une longue période, tiré par la productivité et l’investissement. La question n’est pas de croire au capitalisme. Elle consiste à comprendre que l’élévation du niveau de vie dépend de la circulation du capital vers les projets les plus féconds et que cette circulation exige des règles stables et impartiales.
La destruction créatrice n’est pas un bug
Schumpeter avait anticipé le cœur du phénomène. Chaque avancée technologique détruit une rente, puis en crée une autre plus productive. L’ampoule remplace la bougie, le numérique remplace l’analogique, l’IA industrialise certaines tâches cognitives. Ce mouvement effraie, car il bouscule des positions acquises. Pourtant, c’est précisément ce roulement accéléré des innovations qui explique la hausse tendancielle des revenus réels. Le coût à court terme est visible. Fermetures d’usines, reconversions douloureuses, incertitudes. Le bénéfice à long terme l’est moins. Nouveaux métiers, nouveaux secteurs, meilleurs usages de l’épargne. Freiner l’innovation pour préserver des situations acquises revient à figer l’économie : la croissance ralentit, les opportunités disparaissent et, à terme, c’est l’ensemble de la société qui s’appauvrit.
Exemples concrets en France récente
Plusieurs indicateurs attestent d’une économie capable d’orienter l’épargne vers le risque productif lorsqu’on lui en laisse la possibilité. Les créations d’entreprises ont atteint un sommet historique en 2024. Les ménages ont continué d’épargner massivement avec un flux net de placements supérieur à 110 milliards d’euros la même année. Le financement participatif a dépassé un seuil symbolique en 2024, signe d’un appétit pour des projets concrets à rendement mesuré et à impact identifiable. Ces dynamiques ne sont pas théoriques. Elles illustrent le circuit vertueux qui relie épargne, allocation du capital, prise de risque, innovation, emploi et pouvoir d’achat.
La confusion qui alimente la détestation
La détestation du capitalisme se nourrit de deux malentendus. Le premier confond capitalisme et capitalisme de connivence. Lorsque l’État garantit les pertes aux dépens des contribuables, mais laisse privatiser les gains, l’égalité devant la règle est rompue. Les citoyens perçoivent alors un système injuste. Cette connivence n’est pas le capitalisme. C’est sa perversion. La règle saine est simple. Le risque doit être assumé par celui qui décide et récolte le profit. Le second malentendu confond la règle avec l’issue. Un cadre pro-investissement n’assure pas le succès à chaque projet. Il garantit seulement que la sélection s’opère par l’essai, l’erreur et le mérite, plutôt que par la proximité politique ou l’attente de subventions pérennes.
Le rôle déterminant des droits de propriété
Sans droits de propriété, l’épargne reste liquide et défensive, l’investissement productif se tarit et l’horizon se raccourcit. Les travaux internationaux montrent qu’une meilleure sécurité des titres améliore la qualité de l’allocation et la croissance sectorielle. L’effet ne passe pas seulement par plus de crédit. Il passe aussi par une discipline de marché qui élimine plus vite les mauvais projets. Ce point éclaire un débat brûlant en France. Les dépenses publiques pèsent lourd dans le PIB et l’imposition est élevée. Un tel environnement peut être soutenable s’il protège les biens communs, l’éducation, la justice, l’énergie et les infrastructures, tout en laissant au capital privé la responsabilité disciplinée d’investir, d’innover et de supporter ses pertes. La frontière se trace là où l’État cesse de fixer la règle et se transforme en arbitre et joueur à la fois.
L’enseignement de la parabole des talents
La parabole souvent citée par Charles Gave raconte une vérité économique intemporelle. Le capital doit aller à celles et ceux qui travaillent, prennent des risques et rendent des comptes. Ceux qui enterrent leur talent par peur, ou qui veulent consommer le capital d’autrui sans effort, s’excluent du cercle vertueux. La fable n’impose pas une morale religieuse. Elle pose un principe d’incitation efficace. La rémunération du capital n’est pas une injustice. Elle rémunère un renoncement à la consommation immédiate, un risque assumé et une responsabilité en cas d’échec. Considérer la rémunération du capital comme un simple vol revient à ignorer son rôle d’incitation à investir et conduit, à terme, à une société où il ne reste plus qu’à se répartir la pauvreté. Si la rémunération du capital est niée ou perçue comme injuste, l’investissement se tarit. Sans investissement, il n’y a plus de création de richesse, seulement une redistribution d’un stock qui se réduit.
Depuis près d’un demi-siècle, la difficulté française ne réside pas dans l’élan entrepreneurial de sa population, mais dans un État qui multiplie impôts et prélèvements au point d’étouffer toute initiative privée et toute, ou presque, possibilité de succès. Le mal-être profond de ce pays provient de l’idéologie socialiste érigée comme une norme intangible, qui transforme la redistribution en dogme, entretient la dépendance à l’État et finit par décourager l’effort individuel autant que la création de richesse.
Réponses aux critiques les plus fréquentes
Trois objections reviennent souvent. La première affirme que le capitalisme accroît les inégalités patrimoniales. Les patrimoines se concentrent effectivement, surtout lorsque les marchés d’actifs montent et que l’héritage pèse plus lourd. La réponse ne passe pas par l’entrave à l’investissement productif. Elle passe par l’élévation des compétences, la fluidité de l’entrée sur les marchés et des véhicules d’investissement accessibles, notamment via l’épargne longue et l’actionnariat élargi. La deuxième objection pointe la précarité induite par la destruction créatrice. La bonne réponse consiste à sécuriser les trajectoires par la formation continue, la portabilité des droits et un marché du travail qui facilite la mobilité, plutôt que par la protection de rentes vouées à disparaître. La troisième objection dénonce l’empreinte écologique. La régulation de prix du carbone, la clarté des standards et l’innovation bas-carbone orientent le capital vers des solutions efficientes. L’opposition binaire entre capitalisme et environnement n’a pas de base économique solide. La politique publique fixe la règle. Le capitalisme trouve les solutions les moins coûteuses pour l’atteindre.
Capitalisme contre capitalisme de connivence
La frontière est claire. D’un côté, un cadre où la faillite existe, l’impôt est prévisible, le droit de propriété est protégé, les subventions restent ciblées et temporaires, l’épargne circule vers les projets à rendement risqué mais productif.
De l’autre, un système de rentes où la relation remplace la concurrence, la complexité réglementaire devient une barrière d’entrée et les pertes privées sont nationalisées. La France ne manque pas de talents ni d’épargne.
Le défi consiste à réduire l’écart entre l’effort consenti et la récompense perçue. La simplification des règles, la stabilité fiscale, la rigueur de l’État de droit et le refus des sauvetages systématiques renforcent la confiance. Cette confiance alimente le flux du capital vers l’économie réelle.
Ce que montrent les chiffres récents
Quelques ordres de grandeur éclairent les enjeux. En 2024, la dépense publique a représenté environ 57% du PIB en France, niveau supérieur à la moyenne de l’OCDE. La pression fiscale a reculé en 2023 mais demeure élevée en comparaison internationale. Dans le même temps, les ménages ont continué d’accumuler de l’épargne financière et l’outil entrepreneurial reste très dynamique. À l’échelle mondiale, la part de la population vivant dans l’extrême pauvreté a nettement diminué sur trois décennies, malgré le choc de 2020. Les pays qui combinent sécurité juridique, ouverture économique et concurrence loyale enregistrent des niveaux de revenu par personne et des revenus pour les plus modestes significativement plus élevés que les pays qui restreignent la liberté économique. Les données ne disent pas que tout choix de politique se valent. Elles montrent qu’un cadre pro-investissement et pro-innovation, sous contrainte de responsabilité, corrèle avec de meilleurs résultats pour la majorité.
En guise de conclusion
La charge polémique contre le capitalisme tient souvent à des slogans. Cette mise au point replace la discussion sur son terrain rationnel. Le capitalisme n’est pas l’ennemi. Le véritable adversaire du pouvoir d’achat est le capital immobilisé, la rente protégée, la connivence qui socialise les pertes, la défiance qui bloque la circulation de l’épargne, la sur-réglementation qui décourage l’initiative. Dans une économie ouverte, le refus d’allouer le capital au mérite n’arrête pas la destruction créatrice. Il la déplace hors des frontières et réduit la capacité à financer les services collectifs indispensables.
La France a intérêt à clarifier le sens du mot capitalisme. Il ne s’agit ni d’un totem, ni d’un repoussoir. C’est un cadre de règles qui décide de l’accès à un bien rare. La société qui récompense la prise de risque responsable, protège la propriété, laisse la concurrence jouer et sanctionne la connivence s’offre de meilleures chances d’augmenter durablement le niveau de vie. La société qui veut consommer le capital d’hier pour payer la paix sociale d’aujourd’hui se condamne à un futur plus pauvre. L’objectif n’est pas d’aimer ou de détester le capitalisme. L’objectif est de l’exiger dans sa version adulte. Un code de la route clair, la même règle pour tous, des conséquences assumées et des portes ouvertes à l’innovation. C’est à ce prix que l’épargne se transforme en progrès, que l’ascenseur social redémarre et que le pouvoir d’achat s’améliore autrement que par des rustines budgétaires.