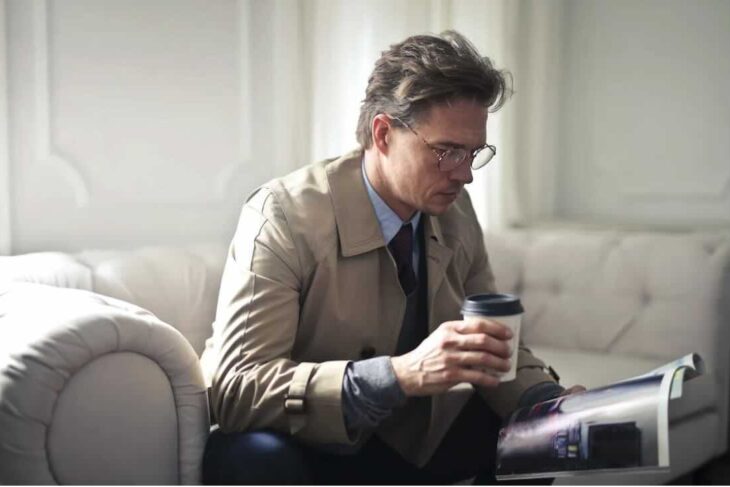3 345,8 milliards d’euros de dette publique au 1er trimestre 2025 et 81 milliards d’euros de déficit commercial en 2024. Ces deux chiffres suffisent à montrer que l’euro agit désormais comme un étau sur l’économie française. Le crédit facile, rendu possible par la crédibilité héritée du “mark partagé”, a gonflé la dette. Dans le même temps, l’impossibilité de dévaluer a asphyxié la compétitivité. Résultat : le pouvoir d’achat, l’emploi et l’investissement se retrouvent coincés entre un argent redevenu coûteux et un taux de change figé qui bloque tout ajustement rapide. Cette double contrainte agit comme une tenaille, réduisant à la fois la marge de manœuvre des ménages et la capacité des entreprises à rebondir face aux chocs économiques.
La dette bon marché transformée en piège
L’euro a donné à la France un capital de confiance qui a permis de maintenir des taux d’intérêt très bas pendant près de vingt ans. En 2016, le taux de refinancement de la BCE a même touché 0%, arrosant le pays de crédits abondants, surtout pour l’immobilier et la dépense publique. Mais avec le retour de l’inflation, la tendance s’est inversée. À l’été 2025, ce taux se situe encore autour de 2,15%. Avec un stock de dette énorme, la facture explose : environ 55 milliards d’euros d’intérêts prévus pour 2025, autant de ressources soustraites aux écoles, à la santé ou à la transition énergétique.
Quand l’ajustement par le change n’existe plus
Avant l’euro, le franc servait de soupape. Entre 1944 et 1987, treize dévaluations ont permis de corriger des coûts trop élevés par rapport à l’Allemagne et de rétablir les prix relatifs. Depuis 1999, ce mécanisme a disparu. Désormais, lorsque la compétitivité s’effrite, il faut ajuster par la baisse des salaires réels, la réduction des marges ou la fermeture d’usines. Ce qu’on appelait autrefois une dévaluation rapide se transforme aujourd’hui en “dévaluation interne” longue et douloureuse.
Une dévaluation ne crée pas de richesse, mais elle change la donne : elle rend les produits français plus compétitifs, décourage les importations et envoie un signal clair. Privée de ce levier, la France doit soit baisser ses coûts, soit innover plus vite que ses voisins. Sinon, ses parts de marché s’érodent lentement, ses marges fondent et l’industrie recule.
Comment l’engrenage infernal s’est-il enclenché ?
Le piège s’est refermé en deux temps. De 1999 à 2016, l’argent facile a nourri la bulle immobilière et la dépense publique, sans gains de productivité suffisants. De 2021 à 2024, le retour de l’inflation a contraint la BCE à relever ses taux et à freiner ses programmes de rachat de dettes, rendant le financement beaucoup plus coûteux. Dans le même temps, l’encours de dette a grimpé à 114% du PIB, soit 3 345,8 milliards d’euros. Chaque hausse minime des taux coûte désormais des milliards et chasse des dépenses pourtant nécessaires.
Une facture extérieure insoutenable
Le commerce extérieur illustre la faillite du système. En 2022, la France a atteint un déficit record de 162,6 milliards d’euros. Même avec une amélioration liée à la baisse de la facture énergétique, le déficit restait encore proche de 81 milliards en 2024. Et si l’on retire l’énergie, le trou subsiste, révélant des faiblesses de compétitivité. L’Allemagne, elle, a mené dès les années 2000 des réformes du travail et une modération salariale. La France a laissé filer ses coûts et a cru que l’euro la protégerait.
A qui a profité l’euro ?
Un récit circule depuis longtemps. Les générations du baby-boom auraient voulu une Europe sans frontières, voyager plus facilement, acheter des résidences secondaires à crédit, parfois passer leur retraite au Portugal. Grâce à l’euro et aux taux bas, elles en ont en effet profité. Mais derrière cette caricature, une réalité pernicieuse existe : les taux faibles et la monnaie forte ont surtout profité aux détenteurs d’actifs et à ceux qui travaillaient dans des secteurs protégés. Pendant ce temps, les salariés des industries exposées subissaient la concurrence étrangère sans filet. La facture se paye aujourd’hui par des impôts plus lourds, des investissements publics sacrifiés et une industrie trop faible pour encaisser les chocs.
Des indicateurs récents inquiétants
Début 2025, la dette publique atteint 114% du PIB. La croissance reste faible. Le coût horaire moyen du travail dépasse 37€ dans la zone euro, et la France figure parmi les plus chers. Faute de gains de productivité, cela pèse directement sur la compétitivité. Sans possibilité de jouer sur la monnaie, chaque hausse de coûts se transforme en handicap durable pour l’économie française.
La souveraineté budgétaire sous tutelle
Certes, l’État garde une marge de manœuvre budgétaire, mais elle est encadrée de toutes parts. Les règles européennes limitent les déficits, et les marchés obligataires sanctionnent immédiatement les écarts, puisque la France ne maîtrise ni sa banque centrale ni sa monnaie. Le “quoi qu’il en coûte” a repoussé les ajustements, mais avec la remontée des taux, la douloureuse est arrivée. L’euro a offert deux décennies de dettes faciles. Aujourd’hui, la contrepartie est une dépendance accrue aux marchés et une charge d’intérêts qui étouffe d’autres priorités.
Ce que changerait un retour au franc
Un nouveau franc se déprécierait probablement de 10 à 20% dès son lancement. Les exportateurs respireraient à nouveau, sans qu’il soit nécessaire de baisser les salaires. L’aéronautique, l’agroalimentaire, le textile ou la chimie gagneraient en compétitivité. Le tourisme aussi deviendrait plus attractif. À condition d’investir dans la production et l’innovation, l’avantage-prix pourrait vite se traduire par des emplois et une réduction du déficit commercial.
Une politique monétaire qui doit assumer son nom
Bien sûr, les importations deviendraient plus chères. L’énergie, les matières premières ou certains biens de consommation augmenteraient. Le risque d’inflation est réel. Mais il peut être contenu par une politique monétaire crédible, un budget maîtrisé et des accords sectoriels qui lient hausses de salaires et gains de productivité. Resterait la dette, en fait une grande partie est régie par le droit français et pourrait être convertie en franc, le reste nécessiterait des négociations, des échéances adaptées et des solutions indexées sur la croissance.
Un scénario de transition existe. Annonce un vendredi soir, gel technique de deux jours, bascule des paiements et conversion automatique des comptes et salaires. Puis flottement du franc, avec interventions limitées de la banque centrale pour éviter la panique. Enfin, un pacte productif national pour transformer l’avantage-prix en emplois durables. L’enjeu est d’éviter que cet avantage ne soit avalé par des importations énergétiques trop chères.
Quel impact sur le pouvoir d’achat ?
À court terme, le panier de biens importés – énergie, électronique, électroménager – coûterait plus cher. Mais à moyen terme, si l’industrie repart et si le commerce extérieur s’équilibre, les salaires réels pourraient rattraper l’inflation. L’euro a surtout enrichi les détenteurs d’obligations et gonflé la valeur de la pierre. Une monnaie nationale, bien gérée, protégerait davantage l’emploi local et offrirait un pouvoir d’achat plus solide, moins dépendant des importations.
Le double piège exige une décision
L’argent bon marché a rendu la dette incontrôlable, et le taux de change fixe a bloqué tout ajustement. Tant que ce double verrou reste en place, chaque hausse de taux coûte plus d’impôts et chaque crise se traduit par des pertes de parts de marché. Le statu quo n’est plus tenable socialement. Retrouver une autonomie monétaire ne serait pas une solution miracle, mais c’est la condition pour reprendre le contrôle du pouvoir d’achat, de l’emploi et de la production. Plus la décision est repoussée, plus le prix à payer sera élevé.
Article connexe : Le FMI aux portes de Paris : l’addition du chaos budgétaire est servie
Sources : economie.gouv.fr, vie-publique.fr, douane.gouv.fr, tresor.economie.gouv.fr, insee.fr, eurostat.ec.europa.eu, banque-france.fr, ecb.europa.eu, euribor-rates.eu, oecd.org, wikipedia.org
Ceci n’est pas un conseil en investissement mais un partage d’information. Faites vos propres recherches. Il y a un risque de perte en capital.